05.07.2015
« La création gémit… » (Rm
8,22)
Brève
présentation de l’encyclique Laudato si’ du
Pape François
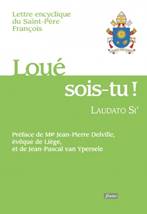
·
Fin juin, le pape a publié une encyclique remarquable
« sur la sauvegarde de la maison commune ». La maison commune, c’est
évidemment notre terre, notre demeure. Or il y a péril dans la demeure et le
Pape pousse un cri d’alarme. C’est la première fois que le Magistère consacre
une encyclique au sujet de la sauvegarde de l’environnement, à l’importance de
l’écologie. Il y a péril dans la demeure, et donc péril pour l’humanité, tant
il est vrai que nous sommes profondément liés à la terre, à la nature. Le récit
imagé de la création de l’homme (Gn 2) montre que
l’Homme est tiré de la terre (Adam
vient de adamah,
la terre), qu’il a une parenté profonde avec la nature, avec la création :
il n’est pas face à elle, mais enraciné en elle.
·
Or « la création gémit » (Rm
8,22), elle est malmenée depuis des années : pollution, changements
climatiques, réchauffement de la planète, épuisement des ressources (eau) et
des énergies (pétrole, gaz…), accumulation des déchets (notamment nucléaires),
perte de la biodiversité animale et végétale, etc. Le Pape, qui a une formation
de chimiste, est bien informé et se base sur les constats scientifiques. Et qui
souffre de tout cela ? Surtout les populations pauvres de la planète (ex.
la désertification), mais tous sont touchés, en particulier les enfants et les
jeunes générations.
·
 Ensuite, le Pape François invite à un
regard neuf sur la création, à partir de Gn 1-2. La nature
a été créée, c’est-à-dire qu’elle est un don
de Dieu : Dieu donne l’être à toute chose et soutient dans l’existence.
Nous sommes ainsi convoqués à l’action de grâce, à la contemplation devant ce
cadeau. Au sein de la création, l’homme a une responsabilité
particulière : sommet de la création, il doit en même temps veiller sur
elle : « Remplissez la terre et soumettez-la ; dominez-la »
(Gn 1,28). On a parfois lu dans cette injonction
divine les racines de la crise écologique, la porte ouverte à une exploitation
effrénée… (cf. Lynn White). En effet, l’homme prométhéen de la modernité s’est
cru tout-puissant, au point de vouloir tout maîtriser, tout dominer. Mais il
faut bien comprendre ce verset : l’homme a la mission de garder le jardin
de la terre, de le cultiver, de veiller sur lui de façon responsable, en
évitant précisément les dérives d’un anthropocentrisme démesuré, qui se
retourne ultimement contre l’homme lui-même.
Ensuite, le Pape François invite à un
regard neuf sur la création, à partir de Gn 1-2. La nature
a été créée, c’est-à-dire qu’elle est un don
de Dieu : Dieu donne l’être à toute chose et soutient dans l’existence.
Nous sommes ainsi convoqués à l’action de grâce, à la contemplation devant ce
cadeau. Au sein de la création, l’homme a une responsabilité
particulière : sommet de la création, il doit en même temps veiller sur
elle : « Remplissez la terre et soumettez-la ; dominez-la »
(Gn 1,28). On a parfois lu dans cette injonction
divine les racines de la crise écologique, la porte ouverte à une exploitation
effrénée… (cf. Lynn White). En effet, l’homme prométhéen de la modernité s’est
cru tout-puissant, au point de vouloir tout maîtriser, tout dominer. Mais il
faut bien comprendre ce verset : l’homme a la mission de garder le jardin
de la terre, de le cultiver, de veiller sur lui de façon responsable, en
évitant précisément les dérives d’un anthropocentrisme démesuré, qui se
retourne ultimement contre l’homme lui-même.
·
Pour le Pape, il est plus que temps d’agir pour la
sauvegarde de la planète, mais tout est lié : écologie, économie,
bien-être social. Des décisions doivent être prises courageusement au niveau
national, international, mais aussi personnel. François invite ainsi à une
« conversion écologique », à une redéfinition du sens même du progrès.
Il s’agit d’accepter de vivre plus simplement, plus en solidarité : moins
de biens, plus de liens. On aura ainsi une meilleure répartition des
ressources, des biens et on réduira les injustices sociales et le fossé
Nord/Sud.
·
La réflexion du « Pape vert » se fait parfois plus
spirituelle, plus contemplative. Le titre Laudato si’ (Loué sois-tu) reprend d’ailleurs le début du Cantique des Créatures écrit par St
François d’Assise, alors devenu aveugle à la fin de sa vie. Dans ce Cantique, chaque élément de la nature
est vu comme un « frère », une « sœur » (n°87) :
 « Loué sois-tu, mon
Seigneur,
avec toutes tes créatures,
« Loué sois-tu, mon
Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère
soleil,
qui est le jour,
et par lui tu nous
illumines.
Et il est beau et
rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très Haut, il
porte le signe.
Loué sois-tu, mon
Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as
formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour frère vent,
et pour l’air et le
nuage et le ciel serein
et tous les temps,
par lesquels à tes
créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et
humble,
et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu illumines
la nuit,
et il est beau et
joyeux, et robuste et fort… ».
·
Chaque élément naturel est ainsi reflet de la
beauté du Créateur et convoque à la louange.
Dans la même ligne, les sacrements emploient des éléments de
la nature (eau, huile, pain,
vin, feu…), à travers lesquels Dieu répand sa vie et sa
grâce dans le monde (n°235).
·
On l’aura compris : la foi doit nous aider à avoir un
meilleur rapport à l’environnement, notre « maison commune ». Puisse
le monde écouter la voix du Pape François ! Au lendemain de son élection,
celui-ci expliquait son choix de porter le prénom du Saint d’Assise :
« François est
pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme qui aime et
préserve la création ; or, en ce moment, nous avons avec la création une
relation qui n’est pas très bonne, non ? ».
Joël Spronck
Eclairage : petit cours d’éco-théologie
Durant
l’année académique 2007-2008, l’abbé Joël Spronck – en collaboration avec le
professeur Emil Piront – a donné un cours intitulé “Théologie et écologie” au Centre
Diocésain de Formation (Liège). Il oppose un démenti à ceux qui jugent le
christianisme coupable de ‘lèse-nature’.
Les
écologistes radicaux accusent souvent le judéo-christianisme d’être à l’origine
de l’exploitation effrénée des ressources naturelles. En ouvrant la Bible aux
premières pages, on lit en effet la recommandation que Dieu fait à l’homme: “Croissez et multipliez-vous, et dominez la
terre” (Genèse 1,28). Mais pour l’abbé Joël Spronck, “la foi judéo-chrétienne peut être un précieux support pour développer
une conscience écologique à la hauteur des besoins de notre temps”. Il trace
les grands principes d’une “éco-théologie”,
une écologie éclairée par la théologie.
Le
judéo-christianisme a profondément repensé le rapport entre l’homme et la
nature. La Bible a ‘dédivinisé’ le cosmos. Les astres ne sont plus des dieux,
mais simplement des créatures. Par rapport aux cultes païens, il y a une
révolution radicale, dans le sens d’une désacralisation de l’environnement
naturel. Mais, souligne Joël Spronck, “s’il
n’est pas divin, le monde n’est toutefois pas ‘étranger’ à Dieu”.
 Le règne de l’homme
Le règne de l’homme
Pour
la foi chrétienne, le monde est un don que Dieu confie à l’homme. Ce dernier
doit régner sur le cosmos à la manière de Dieu. Non pas en exploitant et en
écrasant, mais de manière responsable. Il devient le gérant, le “berger du cosmos”.
L’attitude
des cisterciens au 12e siècle est à ce titre fort emblématique. Ils
n’hésitaient pas à s’installer dans des lieux hostiles comme les marécages pour
maîtriser le chaos naturel et rendre la terre féconde. Un travail de défrichage
et d’assainissement qui reflétait le combat intérieur contre le désordre des
passions mauvaises.
Les
choses vont commencer à dégénérer à l’époque de la Renaissance. Avec la pensée
anthropocentrique, la nature n’est plus considérée comme un don de Dieu. Elle
sera progressivement soumise à la tyrannie de l’homme moderne qui prétend
exploiter ses ressources en maître suprême. “Si
elle est indéniablement source de progrès, souligne l’abbé Spronck, cette exploitation effrénée va aussi
progressivement conduire à un appauvrissement, à une dégradation de la nature,
si bien que la vie de l’homme lui-même est maintenant en danger.
Paradoxalement, l’anthropocentrisme moderne, qui voulait magnifier la grandeur
de l’homme, s’est retourné contre l’homme lui-même.”
La parenté oubliée
Aujourd’hui,
les activistes de la ‘deep ecology’
prétendent rendre à la nature sa sacralité (ligne du New Age). Dans son
encyclique Caritas in Veritate,
Benoît XVI dénonce cette dérive: “Considérer
la nature comme plus importante que la personne humaine elle-même est contraire
au véritable développement. Cette position conduit à des attitudes néo-païennes
ou liées à un nouveau panthéisme.” (n° 48).
Le
pape rejette deux attitudes contraires à la visions chrétienne de la
nature, fruit de la création de Dieu: “soit
considérer la nature comme une réalité intouchable, soit au contraire, en
abuser”. La théologie chrétienne peut servir de ligne médiane, comme le
montrent dans leur cours Emil Piront et Joël Spronck:
“La théologie judéo-chrétienne nous
rappelle que l’homme est un être fait pour l’Alliance avec Dieu, avec autrui,
et aussi avec le cosmos. Cette réconciliation pacifique, que Jésus a inaugurée,
est source de vie et d’épanouissement pour l’homme. ”
Quand
l’homme se coupe de Dieu, il risque de se substituer au créateur et de se retrouver dans un face-à-face avec la
nature, dans une position de dominateur, de manipulateur. Les conséquences sont
clairement néfastes d’un point de vue écologique. “L’éco-théologie est une invitation pressante à réhabiliter la Transcendance…”
En effet, la manière dont l’homme se situe par rapport à Dieu détermine ses
relations avec le monde. Lorsque l’on considère l’homme et la nature comme des
créatures, des dons de Dieu, on redécouvre leur “parenté profonde”. C’est sur cette parenté que se fonde
l’engagement éthique pour la sauvegarde et le respect du cosmos.
Jérémie BRASSEUR